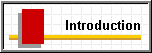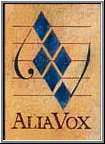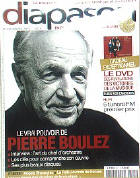1701. Il
y a quatorze ans que Lully est mort lorsque Marin Marais
publie son Second Livre de Pièces de viole. Il y inclut le
Tombeau pour Monsieur de Lully. Arrêtons-nous un instant
sur cette formulation « pour monsieur… ». Sous cette
tournure, issue d’un français vieilli, court comme la
nervosité d’un geste qui évoque moins un hommage qu’un
don, l’envoi fait à un destinataire toujours vivant. Marin
Marais, soit qu’il jette à fresque ses souvenirs du Lully
qu’il pratiqua au sein de l’orchestre, fameux, de
l’Académie Royale de Musique ; soit que sa viole chante
tout ce qu’elle doit à Sainte Colombe, érige moins un
sarcophage, ce mangeur des chairs, qu’un espace prêt à
recevoir pour l’éternité la vie que l’instrumentiste
perpétue. Car la partition est semblable au bulbe d’une
tulipe. Sous ses couches protectrices, elle n’attend que
les feux du soleil pour éclore à nouveau. Le tombeau
musical enclôt l’essence du disparu qui le joue, nous
l’offre par-delà le silence des siècles morts. Et les
fleurs qui attendent de renaître ici n’incarnent pas les
âmes de n’importe qui…
Pourtant, lorsque s’était répandue la nouvelle de la mort
de monsieur de Lully, au soir du 22 mars 1687, tous les
musiciens du royaume l’avaient préféré rongé des vers
plutôt que vivant. Son tombeau, pour lors, ce fut leur
joie. Ils étaient enfin débarrassés de ce tyran qui avait
réduit à quatre leur présence dans tous les théâtres du
royaume, à l’exception du sien, et des quelques salles de
province (Marseille par exemple) qui durent acheter le
privilège de l’opéra et verser sa dîme, fort conséquente,
à monsieur le Surintendant de la Musique du Roi Louis XIV.
Ils firent bien des libations pour fêter son trépas.
Lully, d’ailleurs, s’y fut joint de bonne grâce, tant ce
libertin aimait le bon vin et la bonne chère. Mais, en ce
printemps-là, aucun musicien n’avait oublié qu’il les
avait tous relégués en coulisses, projetant sur le devant
de la scène son seul Opéra. Éclipsé est un terme plus
convenable, tant la carrière de Lully se confond avec le
lever, puis le zénith, de l’astre de Louis XIV.
Adolescent, ce rejeton de minotier florentin, au physique
ingrat et à l’humeur colérique, eut droit aux faveurs de
Mazarin, puis à celles de son filleul le roi.
Rappelons, en passant, qu’il n’existe que six années
d’écart entre Jean-Baptiste Lully, l’aîné, et Louis
Dieudonné de Bourbon, le cadet. À ces âges, le naturel
sait encore rire : voilà de quoi affermir une solide
camaraderie sans laquelle Lully ne fut jamais monté si
haut. Car, à cet étranger, importé par caprice princier
dans un pays viscéralement xénophobe, les ménestrandises
et les confréries musicales n’eurent de cesse de barrer la
route. Lully devint cependant indispensable aux plaisirs
d’un jeune roi qui aimait autant la fête et la galanterie
que son aïeul Henri IV. Lully apprit à ce monarque pubère
la danse et la pantomime. Il le toucha par ses sons, le
magnifia dans les scènes de ballet qu’il imagine pour lui
dès 1654. Ce contact est tout sauf frivole. Il les liera
par l’émotion musicale autant que par la complicité d’une
créativité de tous les instants, à la dépense de laquelle
jamais on ne lésinera.
Lully, avec Molière, Benserade et ce décorateur somptueux
que fut Torelli, fut l’âme de ce véritable âge d’or du
Grand Siècle français que fut la cour galante (1661-1673)
de Louis XIV, le temps béni des maîtresses à foison et des
favorites précieuses, des Marie Mancini et des Louise de
La Vallière. Dans ce tourbillon d’œuvres baroques
scintille le souvenir des semaines de fête des Plaisirs de
l’Ile Enchantée et du Grand Divertissement.
Au terme d’une carrière d’entrepreneur opportuniste, cet
adjectif étant à lire en son sens premier, terme de marine
s’appliquant au capitaine qui connaît le meilleur vent
pour regagner le port, Lully laissa à ses héritiers une
fortune considérable et une formule commerciale pérenne :
l’opéra. Un peu pirate, assez tyran, le Florentin avait eu
le génie de vendre à la ville ce qu’il produisait pour la
Cour. Et lorsqu’on sait le goût immémorial que nous avons
pour les modes et la presse “people”, ce qu’est à sa façon
la tragédie lyrique française, gazette du pouvoir à
déchiffrer sous chacun de ses vers exemplaires, on voit
l’astucieux de la formule, et la fortune qu’un habile
avait à en tirer. Lully, l’opéra, c’était lui, et cela le
restera au moins jusqu’à la mort de Rameau. Et encore, sur
son influence, il faudrait interroger Gluck et
l’inconscient de Wagner, cet autre grand favori d’un roi,
quoique plus bourgeois celui-là…
Haï à sa mort, Lully n’eut pourtant point laissé un si
durable souvenir s’il n’avait eu quelque talent.
Suffisamment pour que, cinquante ans durant, on lui tresse
louanges et apothéoses. Les sonates de François Couperin,
le clavecin de d’Anglebert, le théorbe de Robert de Visée
redonneront longtemps ses airs et ses humeurs. Et qu’il
dut bien ricaner, ce fieffé libertin de Baptiste, en
entendant les incitations à l’amour tirées de sa Galatée
devenir cette dévote chaconne intitulée Le Monument,
retrouvée il y a peu dans un pieux recueil des Ursulines
de la Nouvelle-Orléans ! Homme de synthèse, doté d’un sens
inné de la danse, Lully ne cessa d’écouter son temps pour
transformer tout ce qui lui tombait dans l’oreille. Ainsi
les danses de la cour et celles entendues dans les
provinces françaises deviendront ces suites de danses dont
Bach se souviendra avec le bonheur que l’on sait.
Il amplifia les formes de son époque pour accoucher de
grandes scènes symphoniques, pour lors inouïes. Dans son
moule habile se sont fondus la ciaccona italienne et le
ground anglais. Ostinato : ce rythme fondateur de l’ère
baroque deviendra avec lui ces majestueuses et dansantes
pages orchestrales d’une quinzaine de minutes (autant dire
un siècle d’affects musicaux !) qui couronnent chaque
opéra de sa maturité. Nul doute qu’il y ait, chez Marin
Marais, quelque souvenir de ces transes auditives dans les
Folies d’Espagne et la Sonnerie de Sainte Geneviève du
Mont, toutes deux saisies par la même furie
obsessionnelle.
Homme-orchestre, Lully le fut avant tout. Il fonda la
première phalange en Europe à posséder un effectif stable
et volumineux, tandis que partout ailleurs on ne
connaissait que des effectifs variables, pour ne pas dire
malingres. Sa pâte sonore dense, puissante, constituée de
vingt-quatre violons, d’autant de hautbois, de flûtes et
de cuivres, sans oublier les percussions et un continuo
gras de plusieurs clavecins, théorbes et autres guitares,
quelle révolution ce fut si l’on se remémore, par
comparaison, l’instrumentarium des opéras de Cavalli et de
Monteverdi, que quarante années seulement séparent des
premiers triomphes de la tragédie lyrique française…
C’est cet orchestre, destiné à servir d’exemple pour toute
l’Europe à la faveur de l’exportation politique et
esthétique du modèle versaillais, que rejoint le jeune
Marais à la fin des années 1670. Ce fils de cordonnier
fête ses vingt ans lorsqu’il est appelé dans la cohorte
très fermée des musiciens de la Cour. Il y côtoie les
grandes familles musicales d’alors : Louis, Colin, Jean,
Jeannot et Nicolas Hotteterre, tous de fameux flûtistes ;
sans oublier les cromornes de la dynastie Philidor. A
l’Opéra, il croisera d’autres noms destinés à une même
gloire : ces Monteclair, Desmarets, Gervais, Rebel… tous,
à un moment à un autre, passent par la maison Lully et
produiront nombre d’opéras fort dans la manière du maître
des lieux. On ne jette point si facilement à bas la statue
d’un tel Commandeur…
Marin
Marais
Marin Marais a quarante-cinq ans en 1701. Que restait-il
alors de Lully ? Une tombe, aujourd’hui presque oubliée, à
Notre-Dame des Victoires (1), où Lully le libertin tourne
le dos à l’autel. Et des rancœurs, et déjà beaucoup de
légendes, pour la plupart ingrates, aux trois quarts
invérifiables et jamais de première main. Et beaucoup trop
de ce marbre froid dans lequel le Grand Siècle aima figer
ses grands hommes.
Alors, ce Tombeau que Marais lui construit a ceci de
fascinant qu’il semble presque un témoignage direct sur le
Surintendant. Marin, qui fut batteur de mesure, violiste
et répétiteur à l’Opéra sous son règne, l’a pratiqué
quotidiennement dans sa furie, ses excès et son génie. La
musique de Marais nous parle admirablement de son maître
défunt. Est-ce d’ailleurs un hasard si ce tombeau couronne
la douce-amère suite en si mineur, tonalité « bizarre,
morose et mélancolique », ainsi que le théorise Mattheson
? Lully le flamboyant fut aussi pétri de ces
clairs-obscurs là. Et en fallait-il pour imaginer de
telles œuvres !
Écoutez comme la viole ouvre cette page funèbre. Dès les
premières mesures, c’est la voix d’une héroïne de Lully
que l’on entend. Voici Andromède en Mérope s’épanchant,
voici Armide vaincue par les yeux de Renaud, voici Galatée
la nymphe, folle d’amour et folle de son corps, menacée
par le cyclope amoureux… Toutes ici reviennent rejouer cet
ample geste déclamatoire si typique du récitatif lullyste,
construit de grands écarts, de descentes douloureuses, de
diminutions ambiguës et de ritournelles sensuelles…
Soudain, dans le bas médium de la viole toute prête à
s’éteindre, tombe l’abyssale note d’un bourdon. Ce
battement rogue, est-ce un souvenir de la pompe funèbre
d’Alceste et de ses tambours voilés ? Entendez : il n’est
nul besoin de mots superflus pour exprimer la peine et le
regret. Marais nous restitue cette joie voilée qui rend la
signature harmonique de Lully reconnaissable entre toutes.
Le geste de la viole est un hommage au théâtre du
Surintendant, un art dont Marin Marais tirera profit,
ainsi qu’en témoigne son admirable Alcyone.
Tout autre est le geste enclôt dans le Tombeau pour
monsieur de Sainte Colombe. Si Marin eut Lully comme
maître des biens de ce monde, l’austère Sainte Colombe fut
son maître zen. Ici, c’est le génie capricieux que l’on
interroge, celui qui rend l’esprit sensitif à l’extrême,
exacerbé, douloureux. C’est l’image du musicien tourmenté,
comme le fameux André Maugars, ce cyclothymique violiste
de Richelieu, exemplaire pour les musiciens du Grand
Siècle, exemplaire pour le tragique Sainte Colombe, peu à
peu asséché par les peines que l’on sait. Les larmes
versées de l’intérieur sont souvent les plus destructrices
et Marais ne l’ignore point. Ici son geste s’éloigne du
théâtre mondain pour habiter la scène intime. Il la hante,
il témoigne pour un disparu qui semble toujours aussi
proche dans son souvenir que le vol de ce feu secret qu’il
avait tant réclamé à Sainte Colombe. Ah, cette septième
corde de la viole, ce toucher quémandé à un maître trop
dur par un élève trop jeune !… comment ne pas ressentir
dans ces brisures qui précipitent la plainte et arrachent
à la terrible douleur son masque de bienséance, la plaie
toujours ouverte d’une faute, d’une trahison ? Alors que
la viole, au début, souriait à demi, apaisée, dans le doux
chant d’un haut ténor, la voici qui barytonne et finit par
se déchirer à grands coups d’arpèges fragmentés…
Mais autour du tombeau du maître, le paysage s’épaissit et
se brouille. La viole de gambe bientôt ne sera plus. Les
premières années du 18ème siècle la voient jeter ses
derniers feux. Sa fabrique secrète, son artisanat
laborieux se perdent, comme une mémoire qui ne serait plus
entretenue que par une poignée d’initiés perclus d’années.
Le poids de ce siècle qui fut trop grand pèse sur
l’instrument favori de la chambre et de la ruelle où
naquirent bien des poèmes et des galantises. Bientôt elle
va succomber sous les assauts du violon, ce pitre importé
d’Italie, tout comme Lully. Finie la politesse réservée de
la viole confidente des peines, suranné son chant, oublié
son lyrisme du dedans de l’âme. Rien de cela ne survivra
au nouveau goût, brillant, extérieur. Dirons-nous
exterminateur ?
Pourtant cette voix humaine, morte d’être trop solitaire à
l’orée du siècle le plus sociable qui soit, voilà qu’elle
nous parle de nouveau. Depuis trente ans, elle a reconquis
nos chambres et nos alcôves. Serait-ce parce qu’elle nous
ressemble, à nous, êtres du XXIe siècle, baroques plus que
jamais, qui vivons en un même temps et le clair et
l’obscur, et l’esprit et la chair, et l’un et le divers ?
Fracture, exaltation, faillite, transe : c’est une
humanité traversée d’éclairs qui fonde l’intime texture de
la musique de Marin Marais. Et chaque coup d’archet qui
tombe sur la corde, en rappelant les maîtres morts, ramène
un peu plus de vie en nos natures contradictoires.
Vincent Borel