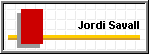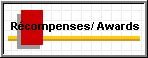Texte paru dans: / Appeared in:
*

Classica # 146 (10/2012)
Pour
s'abonner / Subscription information
Decca
4784732

0028947847328 (ID243)
Consultez toutes les évaluations recensées pour ce cd
~~~~ Reach all the evaluations located for this CD

Vive Agostino Steffani qui, sous le sceau de l’inédit, permet à Cecilia de plier sa voix à une qualité sonore toujours renouvelée!
Agostino Steffani le prêtre-espion, le spin doctor du XVIIIe
siècle, ce mélange de Mazarin et de James Bond, est-il ici prétexte ? Né en
Vénétie, formé musicalement à Munich et Rome, qu’il eût été un homme
d’église à la mode du temps impliqué dans les affaires diplomatiques de
plusieurs cours, voyageant d’Italie en France et en Allemagne, maître de
chapelle de la cour de Hanovre, chargé de missions spéciales pour le Pape,
voilà qui ne le qualifie pas pour être un grand compositeur. Mais c’est
piquant. D’autant que bien des aspects de sa vie sont obscurs (a-t-il été
l’élève de Carissimi ?). Il se peut que «Mission » tire bien un peu beaucoup
sur le marketing historique. Mais les pièces réunies ici, tirées de ses
opéras, et non des duetti, sont toujours bien écrites, parfois même
inspirées. Ne crions pas trop vite au génie, cependant. Le système est tel
que l’on est prié de s’extasier devant des tronçons rapportés de la chasse ;
d’autant que les airs proposés sont en moyenne très courts. Une belle tête
de cheval accrochée au mur ne révèle pas le pur sang. Il faut donc faire
crédit à Steffani, et surtout à Cecilia, enthousiasmée par sa découverte. Et
reconnaître, par exemple, que Niobe, Regina di Tebe, dont quatre extraits
sont ici proposés, doit être un bien bel opéra — avec cet « Amami »
accompagné au seul luth, très beau. Le principal, c’est que s’enchaînent les
battaglie, lamenti, ariosi, permettant de déployer des
coloratures infernales, des spianati parfaits, des pianississimi, des
smorzandi d’outre- monde, tous les affetti possibles, le murmure et
l’éclat, la folie et la tendresse. Bref: vive Steffani qui, sous le sceau de
l’inédit, permet à Cecilia d’exposer tout l’attirail. Mais c’est qu’il est
renversant, cet attirail. Plus que jamais. Parce qu’au-delà des exploits de
virtuosité technique dans le déchaînement des vocalises comme dans le
spianato le plus soutenu (« Notte amica »), dans la concurrence
aux trompettes (par quatre fois ici) comme dans l’évocation nue, on mesure
l’approfondissement de Cecilia Bartoli dans cette discipline de la
voix-instrument. L’important, ce n’est pas la virtuosité. C’est de plier la
voix à une qualité sonore toujours renouvelée. Elle est plus trompette que
la trompette dans « Combatte invite », se fait violon dans «Dal
mio petto », violoncelle dans « Deh stancati », prend des saveurs
de flûte dans «Foschi crepuscoli ». L’art de la vocalise - virtuose
ou non - est si raffiné qu’il varie les reflets dans un même mot ou produit
des effets d’écho intérieur (« Moriro fra strazi »), et l’on sent
poindre plusieurs fois dans l’appui de telle voyelle des parfums d’Orient
(« Amami »), comme si Cecilia retrouvait sous ce baroque précoce les
racines byzantines du chant italien. Ce n’est plus une voix, c’est une
moirure, une étoffe couleur du temps. Il suffit d’écouter les interventions
de Philippe Jaroussky pour, sauf son respect, mesurer la différence. Fasolis
et ses Barrochisti offrent à la chanteuse un miroir chatoyant, où elle se
mire sans retenue - portant à son comble l’art baroque des reflets infinis
et changeants, de la métamorphose impalpable : inouï.
Cliquez l'un ou l'autre
bouton pour découvrir bien d'autres critiques de CD
Click either button for many other reviews